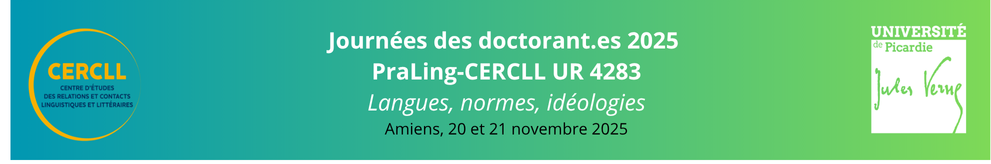
|
|
|
|
Appel à communications Langues, normes, idéologies Journées des doctorant.es 2025 - 3e édition PraLing-CERCLL UR 4283 Université de Picardie Jules Verne 20 et 21 novembre 2025
Généralement conçue comme un modèle à suivre, la norme, dans son acception puriste, s’attache à homogénéiser et orienter les pratiques linguistiques. Cependant, cette conception axiologique ne peut suffire à saisir toute l’étendue de faits rangés sous une notion qui a suscité aussi une conception différente, systémique, de la normativité de la langue et dans la langue (v. Hjelmslev 1942, Coseriu [1952] 2021, Berrendonner 1982, Martin 2020). Envisagée comme un produit social, façonnée par des dynamiques culturelles, la norme laisse apparaître les rapports de pouvoir et les croyances qui influencent la perception du monde, de la langue, des locuteurs. Vectrices d’idéologies, les normes participent à la diffusion de visions du monde qui ne font pas toujours l’unanimité et qui mènent à des débats. Ce qui peut faire émerger des pratiques concurrentes s’écartant de la norme dominante. L’écriture inclusive ou la volonté d’introduire un genre grammatical neutre, par exemple, illustrent comment des évolutions socioculturelles et idéologiques viennent interroger et remettre en question le standard dominant en proposant une norme alternative. En France, l’idéologie puriste, voire fixiste, soutenue par des institutions symboliques comme l’Académie française ou la Commission d’enrichissement de la langue française, vise à guider la conception des locuteurs sur ce que doit être le français, et englobe par là même un positionnement envers la variation (diatopique, diachronique, diastratique, diaphasique), les usages émergents, le contact de langues, le plurilinguisme, le multilinguisme, etc. L’existence même de cet horizon normatif produit des comportements de purisme (Walsh 2014) ou de glottophobie (Blanchet 2016) envers les pratiques langagières des autres, voire d’insécurité linguistique, d’hypercorrection et d’« auto-odi » (Alén Garabato et Colonna 2016) envers ses propres pratiques. Cette idéologie et ses univers de discours ont fait l’objet d’une série de propositions par le collectif des « Linguistes atterrées », qui a publié en 2023 le tract Le français va très bien, merci. Revenant sur la conception mythique du français comme « standard unique » (la « langue de Molière »), la menace que représenteraient les anglicismes, les usages linguistiques des plus jeunes ou encore les transformations dues à la dimension techno-discursive des univers numériques, ce tract propose une vision libérée de la langue, orientée vers la compréhension de ses pratiques actuelles. Cette position a suscité toute une vague de réactions, comme la tribune de Jean Pruvost « Le français ne va pas si bien, hélas », publiée dans Le Figaro en mai 2023, ou encore l’ouvrage de Lionel Meney, La sociolinguistique entre science et idéologie (2024), qui s’attaque au positionnement des Linguistes atterrées. Sans être circonscrit à la langue française et à la francophonie, ce débat permet d’investir plusieurs pistes de réflexion :
Les propositions pourront porter sur les divers questionnements évoqués à titre indicatif dans cet appel ou sur tout autre aspect susceptible d’apporter des éclairages utiles à la compréhension de l’articulation entre langues, normes et idéologies. Les Journées des doctorant.es de PraLing-CERCLL (UR 4283) s’adressent aux jeunes chercheurs et chercheuses en sciences du langage, tous domaines confondus, qui pourront exposer l’état actuel de leurs travaux sans limitation quant aux terrains investis et aux cadres méthodologiques mobilisés. Conférence d'ouverture M. Jean-Marie KLINKENBERG, Professeur Émérite de l'Université de Liège. Ce que nous faisons aux normes. Ce que les normes nous font faire
Bibliographie indicative Alén Garabato C., Colonna R., 2016, Auto-odi. La “haine de soi” en sociolinguistique, Paris, L’Harmattan. Auroux S., 1998, La raison, le langage, les normes, Paris, PUF. Berrendonner A., 1982, L’Éternel grammairien : étude du discours normatif, Berne, Peter Lang. Berrendonner A., 1986, « Discours normatif vs discours didactique », Études de linguistique appliquée, n° 61, 9-17. Blanchet Ph., 2013, « Standardisation linguistique, glottophobie et prise de pouvoir », Cahiers de linguistiques, n°39-1, 93-108. Blanchet Ph., 2016, Discriminations : combattre la glottophobie, Paris, Textuel. Blanchet Ph., Milin R., 2025, Langues régionales : Idées fausses et vraies questions, Paris, Héliopoles. Boudreau A., 2021, « Idéologie linguistique », Langage et Société, numéro hors-série, 171‐174. Calvet L.-J., 2004, Essai de linguistique : la langue est-elle une invention des linguistes ?, Paris, Plon. Calvet L.-J., [1974] 2024, Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Limoges, Lambert-Lucas. Calvet L.-J., 2025, « Science et idéologie : la langue française au filtre d’un débat », Le français dans le monde, n° 457, https://www.fdlm.org/blog/2025/03/31/science-etideologie-la-langue-francaise-au-filtre-dun-debat/. Candea M., Véron L., 2019, Le français est à nous. Petit manuel d'émancipation linguistique, Paris, Editions La Découverte. Canguilhem G., Gohau G., 1978, « Le concept d’idéologie scientifique », Raison présente, n°46-1, 55‐60. Cerquiglini B., Corbeil J.-Cl., Klinkenberg J.-M., Peeter B., 2000, Tu parles !? Le français dans tous ses états, Paris, Flammarion, coll. « Champs ». Colombat B., Combettes B., Raby V., Siouffi G., 2018, Histoire des langues et histoire des représentations linguistiques, Paris, Honoré Champion. Colonna R., éd., 2014, Les locuteurs et les langues : pouvoirs, non-pouvoirs et contre-pouvoirs, Limoges, Lambert Lucas. Coseriu, E., [1952] 2021, Système, norme et parole suivi de Forme et substance dans les sons du langage, trad. Xavier Perret, Limoges, Lambert Lucas. Costa J., 2017, « Faut-il se débarrasser des "idéologies linguistiques" ? » Langage et Société, numéro hors-série, 111‐127. Ferguson Y., Messal S., 2023, « Ce que la machine parlante veut dire. De la révolution technologique à la reproduction sociale », Nouvelle Revue de Philosophie, n° 36-2, 181-194. Frei H., [1929] 2011, La grammaire des fautes, Rennes, Presses universitaires de Rennes. Gadet F., 2024, La variation sociale en français. Nouvelle édition actualisée, Paris, Ophrys. Gadet F., Martineau F., 2016, « Une francophonie mobile », in Neumann-Holzschuh I. et Bagola B. (éd.), L’Amérique francophone – Carrefour culturel et linguistique. Actes du dixième colloque international Français du Canada – Français de France, Trèves, 19 – 21 juin 2014 (Canadiana XVII), Berne, Peter Lang, 11-40. Gasquet-Cyrus M., 2023, En finir avec les idées fausses sur la langue française, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier. Hjelmslev L., 1942, « Langue et Parole », Cahiers Ferdinand de Saussure, n° 2, 29-44. Houdebine A.-M., 2015, « De l’imaginaire linguistique à l’imaginaire culturel », La Linguistique, vol. 51, n° 1, 3-40. Kengue G. F., Maurer B. (dir.), 2023, L’Expansion de la norme endogène du français en francophonie : explorations sociolinguistiques, socio-didactiques et médiatiques, Paris, Éditions des archives contemporaines. Klinkenberg J.-M., 2002, « La légitimation de la variation linguistique », L’information grammaticale, n° 94, 22-26. Klinkenberg J.-M., 2006, « Le linguiste entre science et idéologie. Le discours épilinguistique sur la féminisation commetrace d’un savoir dégradé », in Les enjeux sociaux de la linguistique appliquée, Actes du colloque VALS-ASLA 2004, Bulletin VALS-ASLA. Bulletin suisse de linguistique appliquée, n° 83-2, 11-32. Les Linguistes atterrées, 2023, Le français va très bien, merci, Tracts, n° 49, Paris, Gallimard. Manesse G., Siouffi G. (dir.), 2019, Le féminin et le masculin dans la langue : l’écriture inclusive en question, Paris, ESF Sciences humaines. Martin R., 2020, « La norme comme universel du langage », Journal des savants, n° 2, 629-641. Meney L., 2024, La sociolinguistique entre science et idéologie : une réponse aux Linguistes atterrées, Limoges, Lambert-Lucas. Milner J.-Cl., 1995, Introduction à une science du langage, Paris, Édition du Seuil. Remysen W., Rossi F., Marimon Llorca C., 2021, Les idéologies linguistiques : débats, purismes et stratégies discursives, Berne, Peter Lang. Rey A., 1972, « Usages, jugements et prescriptions linguistiques », Langue française, n°16, 4-28. Siouffi G., Steuckardt A., 2007, Les Linguistes et la norme : les aspects normatifs du discours linguistique, Berne, Peter Lang. Walsh O., 2014, « "Les anglicismes polluent la langue française". Purist attitudes in France and Quebec” », Journal of French Language Studies, n° 24-3, 423-449. |
Calendrier général 30 juin 2025 : Publication de l’appel Modalités de soumission Les propositions de communication devront respecter le format suivant : 1 page maximum, format A4, Times New Roman, taille 12, interligne 1,5 (bibliographie non comprise). Merci d’ajouter une fiche de présentation comprenant :
Les propositions et les fiches de présentation sont à déposer dans l'onglet Nouveau dépôt avant le 01 septembre 10 septembre 2025. Langues de la manifestation Français Format des communications Les communications dureront 30 minutes :
|

